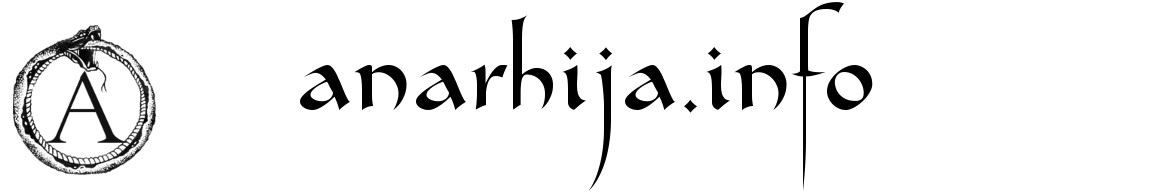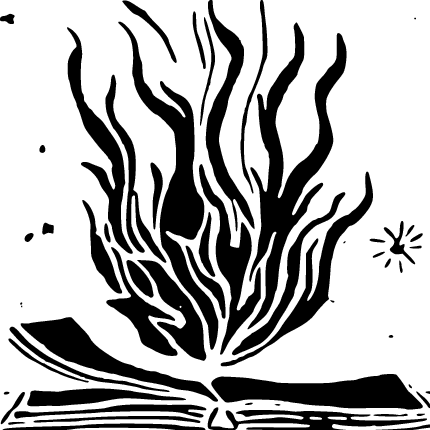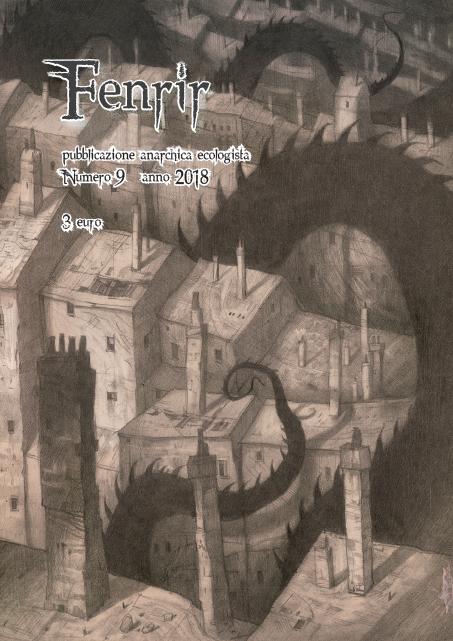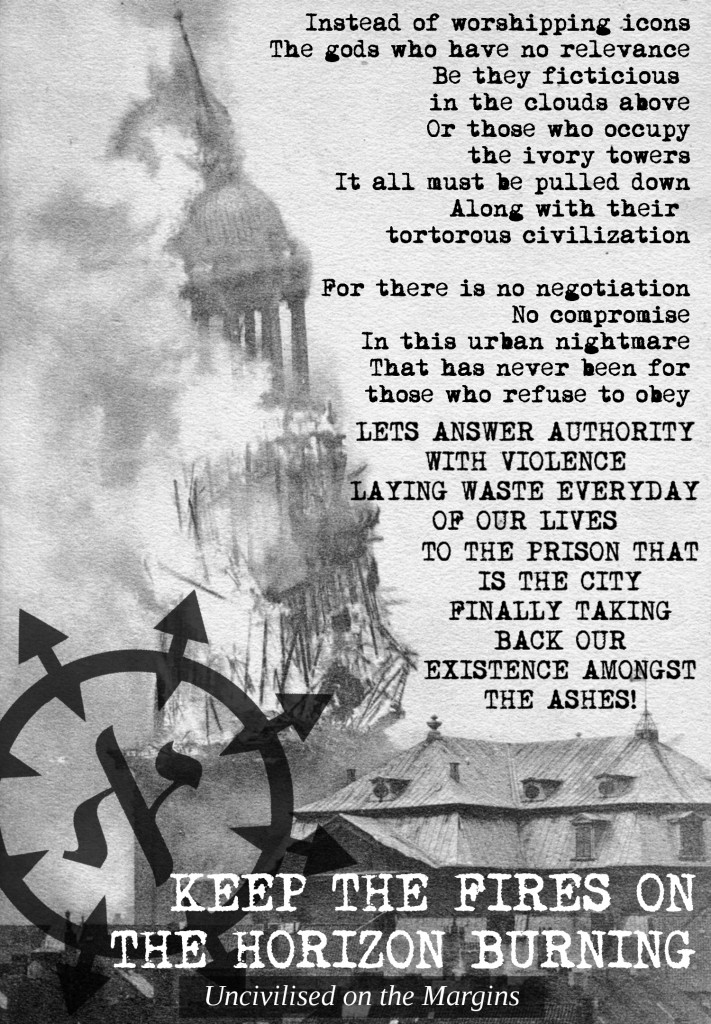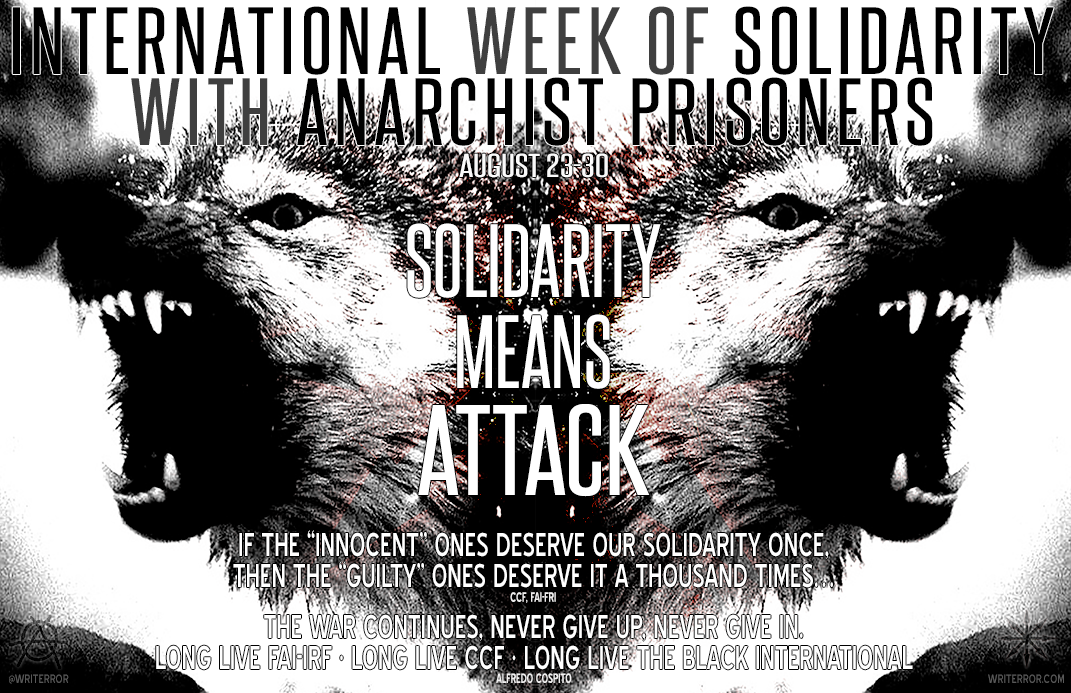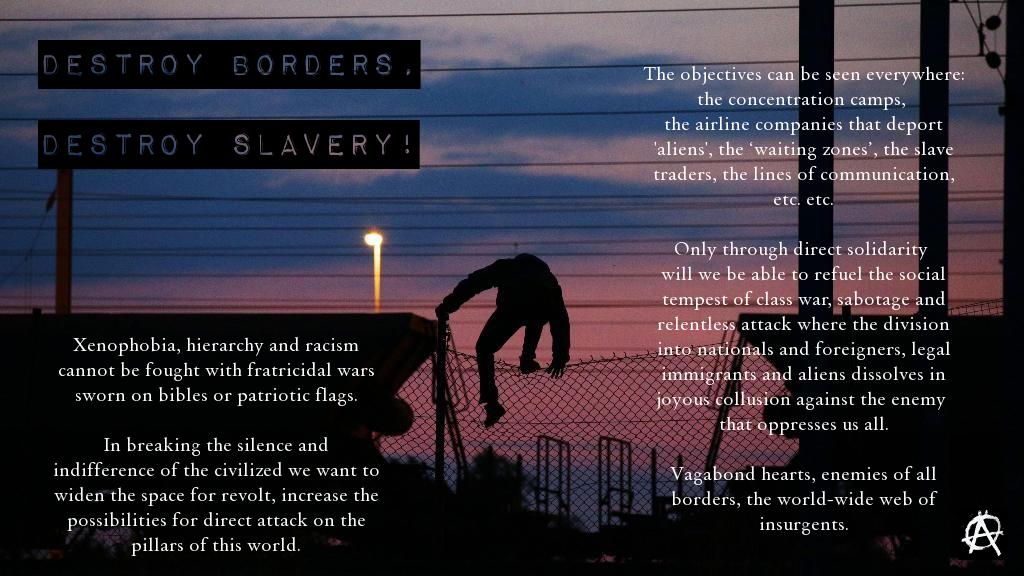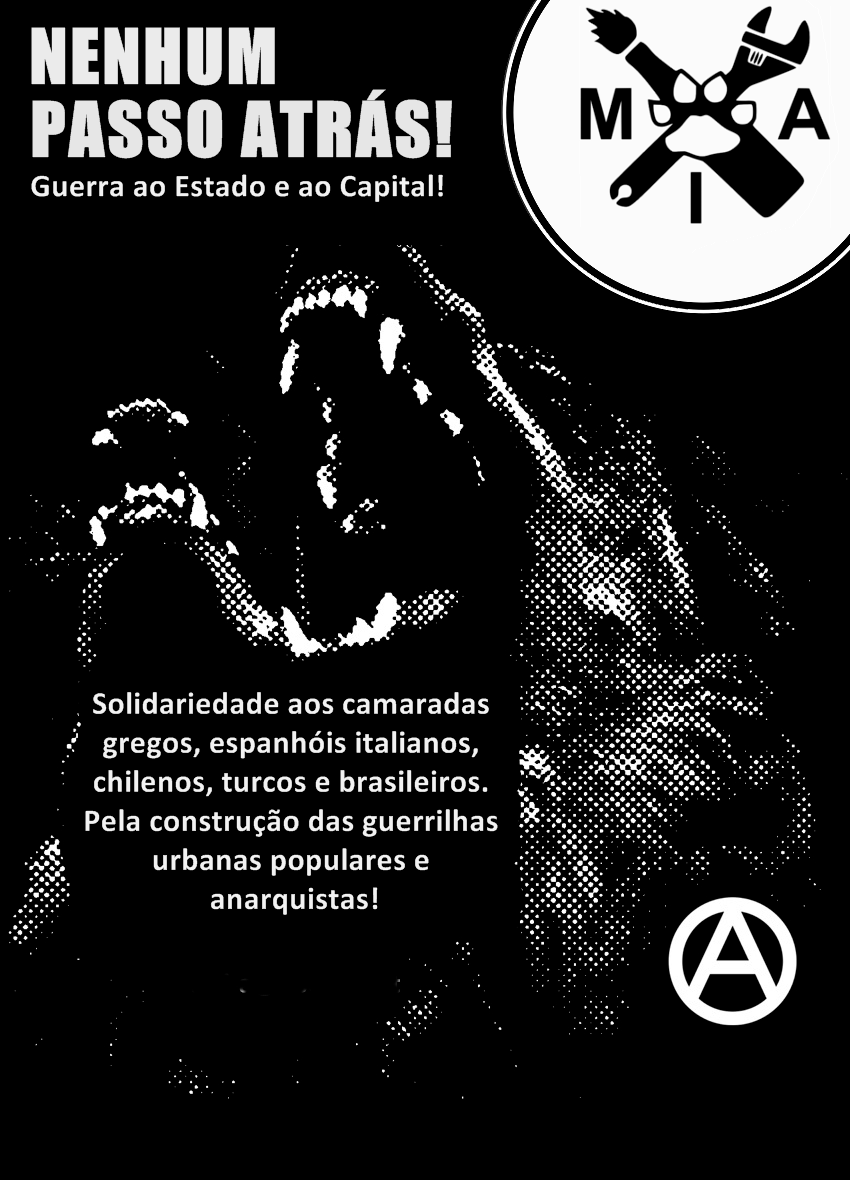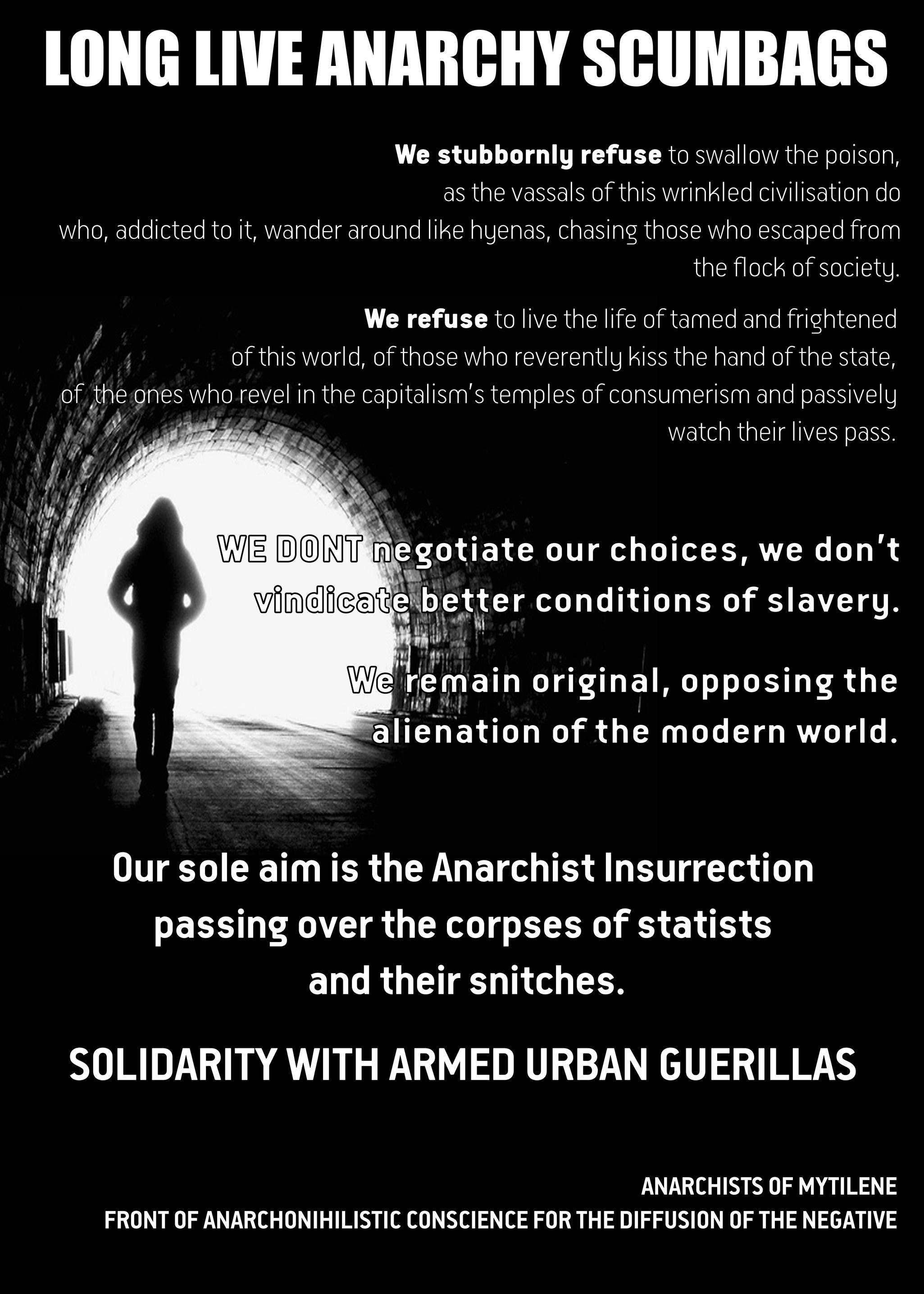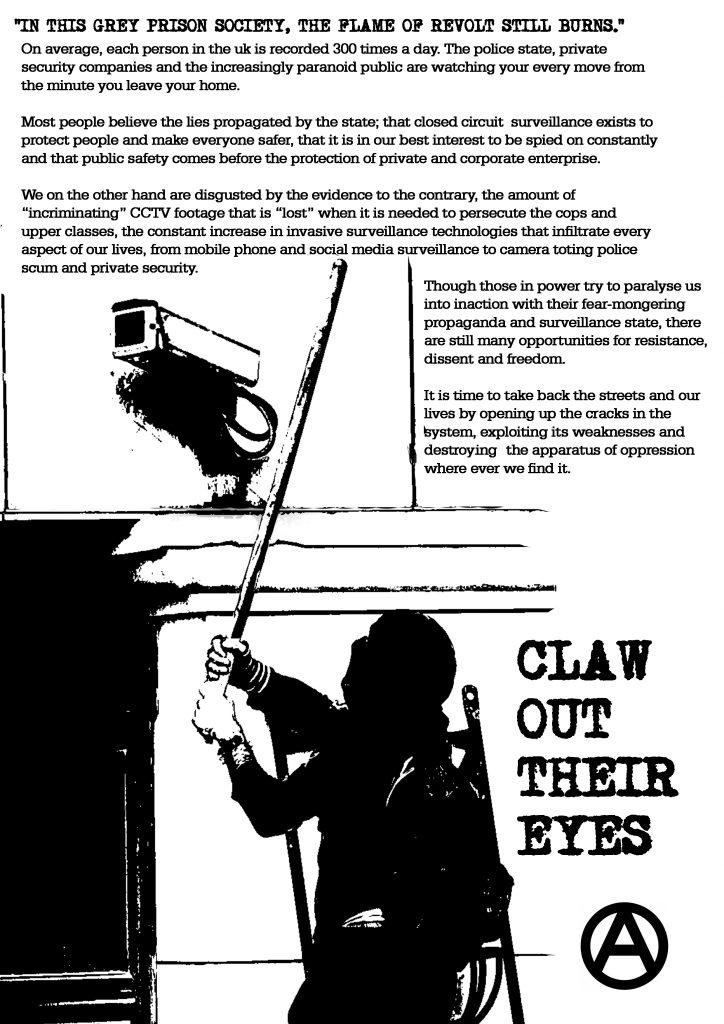Marco Bisesti
Assaut à la perche

Pubblicata la traduzione francese dell’articolo “L’assalto con l’asta. Un incontro sportivo tra lotte e repressione” del compagno anarchico Marco Bisesti (imprigionato a seguito dell’operazione “Scripta manent”). Lo scritto è tratto dal numero 3 del giornale anarchico “Vetriolo” (inverno 2019).
Assaut à la perche
Un événement sportif entre luttes et répression
Vetriolo, giornale anarchico n° 3 / hiver 2019
Après un an de procès, voici aussi, immanquable, ma contribution à propos de la répression.
Le procès qui se déroule à Turin, bien qu’il analyse des publications anarchistes et les parcours de vie des différents inculpés sur une période de quelques dizaines d’années, est avant tout l’énième tentative de faire plier l’hypothèse, jamais abandonnée, qu’il est toujours possible de mettre en œuvre des formes violentes de lutte. Ce n’est pas qu’il fallait ce procès, ou la répression en général, pour rendre cela visible : l’opiniâtre pratique anarchiste se montre par elle-même. Je dis là quelque chose de banal. Mais, au vu de la facilité avec laquelle on prend la lutte contre la répression pour un manuel de défense des libertés octroyées par l’État, il vaut mieux le réaffirmer. Les espaces de manœuvre, les luttes revendicatives habituent à raisonner sur le seuil de la légitimité.
Le caractère distinctif des anarchistes est le refus de la lutte politique. Quand on a à faire avec la répression, on peut, de manière cohérente, choisir de concentrer les forces sur des objectifs spécifiques, sans pour autant abandonner ses valeurs, avec des campagnes qui ne réclament pas des droits, mais qui visent plutôt à améliorer notre capacité offensive. L’affrontement est réel, tangible, inconciliable, violent, bien loin d’une simple logique défensive. Il n’y a pas de place pour la négociation, ni pour les spécialistes du meilleur coup à jouer pour ne pas déchaîner encore plus de répression. Au moins qu’on préfère sacrifier son action, son essence, et se laisser déterminer par les contingences du moment.
Je ne peux pas ne pas évoquer les actions contre la censure qui, en 2017, ont solidarisé avec les prisonniers, en paralysant des nœuds vitaux des télécommunications et de l’information du régime. En frappant concrètement ces haut-parleurs de la parole dominante, on a sapé la tentative de l’État de contraindre au silence ses ennemis.
On pourrait nous dire que, malgré tout, la censure n’a pas changé ses critères, que la répression n’a pas reculé. Des arguments pour ceux qui veulent amadouer la répression, au lieu de l’attaquer. Si on voulait museler l’anarchie, elle a démontré de savoir enlever sa muselière. Peu importe les lois.
Une telle conception d’attaque face à la répression nous met aussi à l’abri des amertumes et des défaites.
Quand on place l’objectif immédiat avant les valeurs, on a une approche différente. Le fait de trop se focaliser sur les mécanismes répressifs, d’en faire des analyses sans fin, est une habitude consolidée qui risque de devenir répétitive si elle est un fin en soi. En oubliant parfois que toute opération anti-anarchiste est une arme de défense de l’État.
La recherche des solutions au problème de la répression est une formalisation de cet oubli, la transformation en terrain de lutte des effets de la répression et non pas des causes qui l’ont déclenchée. La question devient comment se défendre de la réaction de l’État, au lieu de se focaliser sur l’initiative anarchiste. L’essor de brochures, manuels et vade-mecum légaux, en plus de faire planer une certaine aire de poisse, est une expression évidente de cette tendance.
Ces derniers années, des nombreux compagnons sont en train de choisir collectivement de ne pas respecter les mesures répressives préventives. Cela peut porter à faire face à la prison plutôt que continuer à subir la pression exercée par l’utilisation policière d’instruments tel les interdictions de territoire, les obligations, la surveillance spéciale [mesure du droit italien qui peut comporter pour quelqu’un, sur simple décision du Préfet de police, une série d’obligations et interdictions, comme le couvre-feu nocturne, l’interdiction de rencontrer certaines personnes ou fréquenter certains lieux, de participer à des manifestations, etc ; NdAtt.]…
Il s’agit d’une façon de s’opposer à la tentative policière d’endiguer certains mouvements précis. Une modalité qui calque l’habitude de créer les mouvements spécifiques les plus disparates et de raisonner par luttes sectorielles. On a donc pensé d’y trouver l’énième bataille, anti-répressive dans ce cas, dérivée d’autres luttes, et de la mener avec l’outil passif d’une désobéissance civile aux normes. Une lutte revendicative tellement raisonnable qu’elle est partagée aussi par des groupes autoritaires et réformistes qui tiennent à être reconnus dans le théâtre démocratique. Derrière le paravent de la résistance il y a en effet un calcul qui appelle à une plus grande tolérance étatique envers des pratiques qui caractérisent les mouvements frappés par ces mesures préventives. Une conception de la lutte comme des boites chinoises, où l’atteinte d’un certain niveau pose les bases juridiques pour l’action suivante ; quelque chose qui, en plus d’être facile à arrêter, n’a pas grand-chose de libératoire.
Pour avoir une idée des perspectives de cette lutte, il suffit de feuilleter les communiqués qui, depuis différents endroits et depuis longtemps, parlent d’« utilisation massive et indiscriminée de plusieurs mesures répressives » (Rome, novembre 2015) – pas une utilisation ciblée et circonscrite, on pourrait ajouter – ou bien se posent l’éternelle question consolatrice de savoir si la violence c’est un tag ou plutôt une caractéristique de l’État (Como, octobre 2016) ; on voudrait créer un réseau qui permettrait « aux compagnons et aux compagnonnes qui font face aux carcans répressifs d’avoir un peu « les épaules couvertes », du moins pour les petites choses » (Teramo, octobre 2017) ; jusqu’à en venir au tricot législatif sur mesure de la « possibilité d’inverser une tendance de l’ennemi, en plaçant encore plus haut la barre de ce qui peut être pratiqué, sans que la contrepartie puisse réprimer toute possibilité d’action » (Turin, juillet 2016).
Comme cela est arrivé dans un passé récent, quand on a dessiné les limites d’un sabotage acceptable, on vise ici à bien différencier les pratiques, dans le cas précis entre celles qui peuvent être réprimées et celles qui sont moins dangereuses, pour soi-mêmes mais aussi, de toute évidence, pour cet État qui devrait les garantir.
On continue à théoriser que lutter contre la répression signifie avoir prise sur le Code pénal.
On ne peut pas viser à légitimer un certain niveau d’affrontement, sauf si on fait preuve de naïveté ou de prétendue ruse vis-à-vis de l’adversaire. Quand on a l’illusion d’y arriver, c’est parce qu’on est passés dans le camp de la négociation, de la récupération. Je veux, avec cela, dire de façon gentille que la limite entre naïveté et opportunisme est mince.
Il suffit de penser au parcours de situations comme celle de Turin. Les compas de cette ville, partisans de la lutte contre les mesures préventives, utilisées contre le mouvement qui s’oppose aux expulsions locatives, en sont arrivés à envisager une lutte « plus réaliste », pour l’attribution de logements HLM. Voilà la flatterie de la récupération ! La légalisation des squats, et même en retard de quelques décennies par rapport aux pionniers réformistes des centres sociaux. Déçu de ne pas arriver à une dépénalisation des pratiques de résistance aux expulsions locatives, ce mouvement a décidé de faire encore un pas en arrière. Un rebond normal, pour une logique gradualiste.
En se cachant derrière le doigt d’une lutte contre les mesures répressives, on passe pour des intransigeants, mais de façon instrumentale, afin de cautionner des instances légalistes. On exploite, avec des pratiques syndicalistes, des mouvements (plus ou moins fictifs) pour assurer à ses luttes un futur sans soucis judiciaires. Ou bien on pense de créer une base juridique pour le débouché insurrectionnel tant attendu ? Comme l’exemple de Turin nous le montre, la recherche des portions de légalité verrouille la possibilité d’atteindre une hausse, pourtant si souvent évoquée, du niveau des luttes ; bien au contraire, elle les enterre dans l’habitude d’une militance possible. Essayer d’influencer le niveau de ce qui est permis signifie souhaiter une reconnaissance des pratiques, pas leur renforcement. Un renversement des perspectives qui fait penser, plus qu’à une intervention des anarchistes dans la société, à une intervention de la société chez les anarchistes. D’autant plus si cela est proposé non pas par des vagues mouvements populaires sur la voie de la radicalisation, mais par les « bandits », comme ils s’appellent eux-mêmes – sur la voie de la dépénalisation.
Ce glissement de la signification de « banditisme » est une aberration elle aussi : normalement il devrait mener à se mettre au vert pour ne pas succomber. Le banditisme d’aujourd’hui réclame, quant à lui, sa propre légitimité. Une légitimité qui ne signifie pas, disons-le en passant, un enchevêtrement individuel de pensée et d’action, un processus personnel, mais au contraire, un caractère licite reconnu par le bon sens commun. Une ethnique libérale. C’est à cause de cela aussi que le néo-banditisme présente les mesures répressives préventives comme un héritage du XIX siècle et de l’époque fasciste, un outil vétuste inadapté à cette époque de démocratie avancée. C’est pour cela aussi qu’on se soustrait aux mesures répressives et puis on attend les conséquences en public, dans la tentative de susciter de l’indignation à cause de l’acharnement policier. On célèbre la constance comme étant la meilleurs réponse à la répression, mais on espère par ailleurs que cette dernière se ravise. Parce qu’au fond c’est moins traumatisant de parler seulement des barrières qui nous sont imposées, plutôt que de reconnaître celles derrière qu’on se donne par soi-même. La lutte peut continuer, mieux si c’est le mains en l’air, à petits pas et avec le dos couvert.
Mais la répression n’est pas seulement celle qui vient frapper à notre porte quand on est devenus ennuyeux. On ne peut pas toujours en discuter à posteriori. Elle est un des pilier de l’État. Elle existe et fonctionne au delà des moments pendant lesquels elle nous apparaît ouvertement, avec ses décrets et ses opérations policières. Il est donc possible de la combattre en laissant de côté toute approche défensive. Trouver les failles de l’État et frapper parce qu’on est contre l’État. Voilà tout. Dans cette optique, des nombreuses considérations sur l’efficacité d’une lutte à la répression faite en se léchant les blessures sont limitantes. Les dépasser serait le meilleur chemin aussi pour laisser de côté la commisération et penser de façon positive, en arrêtant de calculer les gains de la lutte, mais au contraire en essayant d’être incisifs sans chercher une contrepartie à exhiber comme une victoire.
Face à des tels élans possibles, je me demande donc qu’est ce qui se passerait si on obtenait que l’État place la barre de sa tolérance de plus en plus haut.
Peut-être que la chose la plus probable est que ce seraient de moins en moins nombreux ceux qui essayeraient de sauter au dessus de cette barre, en visant le ciel, et de plus en plus nombreux ceux qui se contenteraient du frisson de l’effleurer avec leur menton, les yeux rivés vers le haut, regardant de loin ce même ciel pendant qu’ils dansent un Limbo tout à fait légal.
Marco
prison d’Alessandria, été 2018
____________
Pour lui écrire:
Marco Bisesti
C.C. San Michele
Strada Casale, 50/A
15121 – Alessandria